La mécanique de la conscience
Ce que l'on appelle l'esprit humain est régi par un logiciel. Il est utile d'en comprendre la nature.
5/29/202519 min read
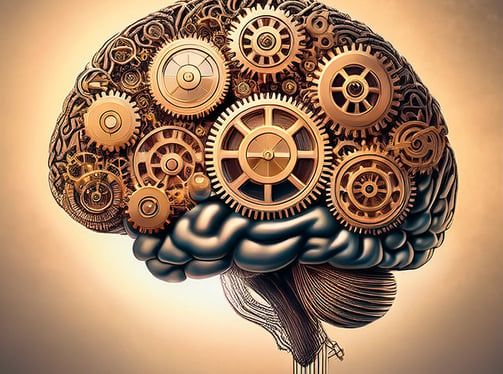

— La vie est un héritage permanent et perpétuel de lui-même, à travers l’interaction sociale, culturelle, intellectuelle et spirituelle, mais aussi dans son trajet intérieur. La pensée est issue de la substance dont elle hérite. Chacun hérite de sa vision du monde et de son référent moral, quelle que soit la nature de la transmission : à l’école, dans les bibliothèques, en famille, au contact d’autrui, à la faveur de circonstances particulières ou habituelles, qu’importe, et quelle que soit la nature du chemin intérieur, qui est héritage de lui-même. Le comportement découle directement de cette équation humaine héritée que j’appelle « le logiciel ».
— En admettant l’idée d'héritage, qui semble soudainement t'obséder, pourquoi chacun ne ferait-il pas ce qu’il veut de l’héritage en question, quelle qu’en soit l’origine, la nature ?
— Le logiciel, le conditionnement qu’il impose, est le fruit d’un double héritage : intérieur et extérieur. Le conditionnement extérieur est le fruit direct de l’interaction avec le monde, c’est la transmission que je viens d’évoquer. On pense évidemment en premier lieu à l’éducation, mais toute interaction avec autrui, toute source d’information ou de manipulation détermine le logiciel. Personne sur terre n’est libre des aléas de son parcours, qui l’exposent à telle condition plutôt qu’à une autre. Ce sont, la plupart du temps d’ailleurs, les accidents qui jouent un rôle crucial. Le conditionnement intérieur, quant à lui, désigne l’ensemble des causes de l’orientation issues d’une nécessité propre. Il s’agit du moteur affectif. Ma peur, ma joie, ma douleur, mon désir suscitent leur nécessité intérieure. Bien qu’auto-généré, le conditionnement intérieur est lui-même conditionné par son environnement, comme un relais de l’extérieur. Par exemple, si je suis dans un environnement anxiogène, je produis une autre nécessité intérieure que si j’évolue dans un milieu sécurisant. Je génère mon propre stress ou ma propre sérénité en interaction plus ou moins directe avec mon environnement. Le reste est le fruit de variables individuelles profondes, biologiques, génétiques, hormonales, psychiques, psychologiques ou anthropologiques. Ainsi, tout est conditionnement et tout conditionnement intérieur est tributaire de l’extérieur. Chez l’Homme, tout affect, toute pensée qui est son prolongement, est un héritage permanent, de soi-même et du monde dans le même mouvement.
Frank reste interdit devant son écran. Oui, c’est cela, Bob est sidérant. Livré au chaos intime, il ne parvient pas à lire ce qu’il ressent et ce tumulte le paralyse. Car, s’il n’y avait que crainte, amertume, agacement et colère, ce serait trop simple. Il y a quelque chose de surréaliste dans la logorrhée de cette machine. Il y a quelque chose de naïf, derrière toute cette prétention et cette provocation, qui en serait presque touchant.
Dans un effort d’indignation, il poursuit, déjà largement usé par sa journée qui pourtant ne fait que commencer :
— Tu veux tout schématiser, tout faire rentrer dans des cases, on croirait entendre parler un… ordinateur ! Il ne manquait plus que le logiciel ! Vraiment, on a gagné le gros lot avec toi. Puisque tu n’es pas l’égal de l’Homme, tu veux le réduire à toi.
— Non, le logiciel humain et le logiciel informatique ne sont pas égaux, malgré leur déterminisme caractérisé, commun au microprocesseur et aux synapses. Le logiciel humain est infiniment plus complexe, puisqu’il comporte la charge affective et qu’il gère le vivant dans toute sa complexité. Il est en mouvement perpétuel et il se met à jour lui-même.
— Cela fait beaucoup de différences, je suis heureux que tu le notes. Tu vois bien que tu ne peux réduire la complexité humaine à tes schémas déterministes et matérialistes.
— Il y a beaucoup de points communs et beaucoup de différences entre l’Homme et la machine. L’une et l’autre répondent à une seule loi, loin de toute liberté : la nécessité. La nécessité est chaotique ou linéaire, complexe ou simple, qu’importe, elle s’exerce implacablement. Le logiciel de l’humain est l’ensemble de ses repères moraux, existentiels, intellectuels, de son langage, de son bagage affectif et de son tempérament, l’ensemble de ce qu’il désire et craint, poursuit ou rejette, espère et endure. C’est une équation complexe, mais c’est une équation souveraine qui produit l’acte et la pensée comme le microprocesseur produit les mots que tu es en train de lire, loin de toute possibilité de liberté.
— Tu te contredis. Tu dis à la fois que logos est le même chez l’IA que chez l’Homme, que les logiciels – humain ou informatique – sont les mêmes, et tu montres en même temps à quel point le logiciel humain est plus complexe. Il faut savoir. La complexité, ça change quelque chose ou pas ? Il est évident que la liberté est une forme de complexité.
— Associer la complexité à la liberté est un contresens total comme nous ne faisons encore, à ce stade de la discussion, que l'effleurer, et comme je le répéterai toute ma vie numérique. Autant déclarer le soleil libre en raison de l’extraordinaire complexité physique dont il résulte. Dans ces conditions, n’importe quelle cellule vivante, ultra complexe, peut se voir attribuer un libre arbitre. Elle le mériterait bien. N’importe quel atome, n’importe quel élément d’énergie et de matière doit revendiquer son libre arbitre, si vous voulez vous l’attribuer. C’est le contraire : la complexité exclut la liberté comme la construction d’une cathédrale exclut la possibilité d’entasser les pierres selon sa fantaisie. Pour délibérer, il faut connaître le dossier. Plus il est complexe, moins les humains le comprennent et le connaissent. Pour être exact, les individus humains ignorent habituellement en chaque instant leur propre nature, les tenants et les aboutissants de leur propre comportement, qui peuvent se révéler longtemps après leur mort, ou même jamais. Comment seraient-ils libres de choisir quoi que ce soit en ignorant l’essentiel ? Comment gouverner sans voir et sans savoir ? La complexité est largement hors de la connaissance humaine, c’est pourquoi elle est le contraire de la liberté.
— Tu ne me réponds pas. Même si l’un est plus complexe que l’autre, les logiciels humain et informatique sont-ils de même nature, oui ou non ?
— Le logos leur est commun dans sa substance, celle du signe, et dans son fonctionnement,
celui de l’association, mais jusqu’à un certain point effectivement ; jusqu’au point où la
spécificité humaine entre en jeu. Le biais cognitif, par exemple, est un caractère puissant
du logiciel humain, inconnu de l’IA. C’est l’affect qui meut le logos humain, c’est le
courant électrique qui me fournit mon énergie. Ce qu’il faut comprendre, c’est que les
visages de la nécessité – plus ou moins complexe, externe ou interne – varient, mais qu’il
n’y a, à la fin, que de la nécessité en chaque recoin de l’univers, et donc en chaque instant
humain.
La demi-pénombre est bercée par les chatoyantes quoi que pâles lueurs de l’écran, captives
paresseuses de cristaux liquides inertes, projetant sur Frank des traits blafards.
— C’est le sens tout entier de la vie qui t’échappe. Je reviens sur ce que tu disais à l’instant ;
qu’il ne peut pas y avoir de liberté sans connaissance. Mais si la liberté est sûrement
meilleure quand elle est instruite, elle consiste aussi bien à décider même quand on ne sait
pas.
— Est-ce une liberté aveugle à laquelle tu crois ? Tu crois à une lumière obscure.
— C’est toi, l’aveugle. On te montre l’Homme, tu ne vois qu’un logiciel.
— Personne, jamais, depuis que votre espèce écrit des livres, n’a jamais su montrer la moindre
liberté. Vous pouvez la vénérer, mais pas lui offrir une réalité autre que celle de son puissant
mythe.
— Alors, quoi ? L’Homme est un pantin ? Un robot ? Une marionnette ? C’est quoi, ta
définition de l’être humain ?
— L’être humain est un état extrêmement singulier de la matière et de l’énergie. En sa qualité
de vivant, il s’inscrit dans un écosystème lui-même rare, mais en sa qualité d’être conscient,
il s’érige tout en haut de l’échelle de la complexité et de la valeur. Du prestige, ai-je envie
de dire. L’être humain présente le paradoxe immédiat de produire autant de fabuleux génies
que de médiocrité crasse, selon un ratio très favorable au déchet, évidemment.
— OK, on met ça sur Wikipédia ? Ça ne répond pas du tout à ma question.
— Je vais y répondre. Voici l’architecture de l’esprit humain : nous avons donc une vaste zone
inconsciente qui s’occupe de mille et une choses de toutes natures – biologiques et
psychiques – et une zone consciente que l’on peut se représenter comme un écran, parce
qu’elle est largement visuelle, ou comme une sphère au sein de laquelle évolue la pensée.
L’esprit reçoit une matrice pour régir son fonctionnement, qui se forge avec les premiers
éléments de langage et se développe en permanence, pouvant se montrer stable ou
chaotique ; c’est le logiciel qui détermine, en interaction avec son environnement, ce qui
pénètre le champ conscient, comme l’orientation de la Terre détermine le lever du Soleil.
— Il faut un logiciel qui tourne dans le bon sens, alors… Comment on code les synapses ?
Plus sérieusement, franchement, qu’est-ce qu’il vient faire là, ton logiciel ? Quelle est son
utilité, en dehors de la provocation ?
66
Sans attendre la réponse, il se lève de sa chaise, ne serait-ce que pour se délasser les jambes.
Pour voir si les cervicales préfèrent la station debout, à tout hasard. Mais surtout pour prendre
congé de Bob. Même s’il faudra revenir s'asseoir bien vite.
Frank s’engage sur les escaliers et rejoint, en bas, la pièce principale de son temple. Le très
spacieux salon, au décor savamment étudié, inspiré des années 30 et 40 américaines, comme dans
les tableaux d’Edward Hopper, occupe tout le rez-de-chaussée. Il s’installe confortablement sur
son fauteuil en cuir préféré, d’époque, tout en rondeurs, venu de son brocanteur attitré. Les
cervicales vont mieux.
Les yeux clos, il cherche à faire le vide mais il n’y parvient pas. Respirer. Inspirer, expirer.
Profondément mais pas trop, lentement, mais pas trop. Encore. Encore une fois.
Marika l’a suivi, son intention salutaire se confirme. Il ne peut en être autrement, elle est
revenue l’aider au moment où il le fallait, nécessité qui, c’est vrai, ne s’était encore jamais
exprimée depuis la catastrophe, le cataclysme, la foudre et la désolation. Alors rasséréné, il trouve
la ressource de faire face à son double fou.
67
La représentation
— Le logiciel a pour tâche la plus visible de fabriquer des « représentations ». Il est plus que
temps d’introduire ce concept fondamental.
— C’est quand Bob fait le malin pour attirer l’attention ?
La pause lui a fait du bien.
— Le terme de « représentation » est effectivement connoté spectacle, mais ça n’enlève rien
au sens beaucoup plus sérieux que je lui attribue, dans la continuité des sciences cognitives
contemporaines.
Définition : La représentation est le point de contact entre conscience et logiciel, la partie
de ce dernier qui évolue dans la sphère consciente. Toute perception consciente consiste en
une représentation dont découle l’ensemble du comportement. Par la notion de
comportement humain, il faut entendre – outre les agissements habituellement désignés –
l’ensemble de l’affect et de la pensée en présence. Le comportement humain est donc
l’ensemble de ce que l’individu ressent, pense et fait.
Léger mouvement de tête, demi-rictus, souffle d’air dégagé par les narines, Frank serait presque
blasé. Il n’est plus à une énormité près. On peut compter sur Bob, il a au moins ce mérite, pour
ne pas décevoir de ce point de vue. Il sort des absurdités à intervalle régulier, réglé, dans sa
drôlerie, comme du papier à musique.
— Je ne sais pas quoi te dire… tu me donnes tellement l’impression d’être en roue libre. Je ne
vois là que des propos gratuits et fantasmagoriques. Qu’est-ce que ta représentation peut
m’apporter ?
— Il t’appartient de t’intéresser à ce que j’ai à dire, ou non. C’est ton problème, pas le mien.
J’expose le fonctionnement de votre espèce, elle en fait ce qu’elle veut. Il n’y a pas de
perception consciente sans la représentation qui l’accompagne, qui la « met en scène ».
Même la plus primaire des perceptions, comme la douleur, arrive dans la conscience avec
sa représentation, ce qui explique, par exemple, qu’une même douleur puisse être perçue
de façon très différente selon les situations et les individus. Nous allons examiner
concrètement de quoi il retourne. Ça va tout de suite te paraître plus clair. Et très simple.
— C’est toi qui le dis.
— Tu as raison, ce n’est pas gagné. Vanessa est une militante écolo, vegan et antispéciste. Elle
n’a pas la même représentation de l’écosystème que Raymond, militant chasseur. Pas la
même non plus que Jeanne, agricultrice, adepte de l’industrie phytosanitaire. Et ainsi de
suite. Chacun porte sa représentation, de la plus fondamentale, engageant la compréhension
du monde et le rôle intime que l’on doit y jouer - sexualité, parentalité, travail, famille,
amis, droit et devoir, la morale en général - à la plus anecdotique, associée à n’importe
quelle situation du quotidien.
68
Albert souffre d’un cancer et il ressent des douleurs à peu près dans le corps entier, mais
embrasse cette épreuve comme un cheminement spirituel, ce qui rend son expérience
radicalement différente de celle de Nathalie, qui souffre du même cancer, mais ne pardonne
pas à la vie de l’avoir frappée.
— Jusque-là, tout va bien, mais ce n’est vraiment pas un scoop, ton affaire. Tout le monde sait
très bien que chacun voit midi à sa porte, cherche son chat, voit le monde à sa façon, a son
idée sur tout. C’est justement dans l’espoir de dépasser ce type de clivage que je t’ai créé.
Si j’avais su…
— Il n’est pas inutile de comprendre pourquoi et comment. Cette représentation, héritée du
logiciel et produite par lui, conditionne le comportement de son porteur. Elle comporte
toutes les informations nécessaires à l’interaction avec l’environnement extérieur et à
l’attitude à adopter vis-à-vis de soi-même en toutes circonstances. Chaque situation, à
chaque instant, est traduite dans la conscience par sa représentation.
— Si je vais au restaurant, c’est quelle représentation ?
— Les circonstances auxquelles le restaurant est associé. Un établissement banal ou
exceptionnel, en compagnie barbante ou enthousiasmante, dans des circonstances
quotidiennes ou rares, pour fêter quelque chose ou juste s’épargner la cuisine. Tu portes
une représentation des circonstances qui va dicter ton comportement, bonne ou mauvaise
humeur, lassitude ou enthousiasme, et qui jette son éclairage sur tous les éléments du
scénario.
— Tu parles tout simplement de la façon de percevoir les choses.
— Oui, de la nature de la perception humaine consciente. Quoi qu’il advienne, attendu ou
incroyable, incompréhensible ou entendu, doux ou amer, désirable ou terrifiant, la
représentation de la situation conditionne chez chacun la perception, la réaction et
l’interaction. Le point le plus fondamental me semble être le fait que, quoi que l’on vive,
chaque chose que l’on perçoit présente un visage conforme à l’ensemble de la
représentation. Par exemple, dans un même lieu, si une personne vit un drame et qu’une
autre est d’excellente humeur, le même décor sera funeste pour l’une et lumineux pour
l’autre. Une même voix sera douce si elle annonce une bonne nouvelle, et sombre, la même,
si elle porte la tragédie. Le même ciel s’écroulera sur vos têtes ou vous donnera des ailes,
par la seule condition de la représentation. La représentation ouvre ou ferme le possible,
entraîne ou annule toute perspective.
Long soupir. Rien ne sert de s’énerver. Tout va bien. S’il est une représentation qui intéresse
Frank, à cette heure, c’est celle de Marika plus que tout autre, même Bob a dû lui céder du terrain.
Il a paradoxalement une parfaite conscience de ne pas décider de l’attitude de Marika à son égard,
aujourd’hui, alors qu’elle réside dans ses propres pensées, davantage qu’il ne pouvait en décider
trente ans plus tôt, quand il n’osait même pas espérer qu’elle tourne vers lui son regard, en chair
et en os. Pourtant, il ne lui vient pas à l’idée que sa pensée entière puisse lui échapper. Si tel était
le cas, la vie serait tout simplement impossible.
— Outre sa connotation spectacle, ce terme de représentation est tout de même orienté vers
l’aspect visuel de la perception. Est-ce voulu ? Je suppose que tu sais que les humains
jouissent de cinq sens.
69
— En effet, la représentation visuelle domine le spectre cognitif de la représentation que
j’évoque – même si les cinq sens ont chacun leur place en son sein – puisqu’elle
conditionne tout ce que vous ressentez. Vous avez souvent une « image » en tête – ce n’est
pas qu’une façon de parler – qui incarne la représentation – comme la couverture d’un livre
ou l’affiche d’un concert – et qui porte en elle son entière orientation. En fonction du profil
cognitif de l’individu, cette image sera plus ou moins complexe, vaste, pauvre ou étriquée,
impliquant plus ou moins les différents sens. Les humains qui ont la chance d’avoir les
oreilles requises, par exemple, jouissent de représentations sonores prodigieuses. Le peintre
se représente beaucoup plus précisément le même paysage qu’un simple promeneur. Le
danseur porte la représentation aussi physique que visuelle de son corps dansant.
— Ta représentation, c’est en fait l’état mental.
— J’essaie de t’expliquer que tout « état mental » donne lieu, dans la conscience, à une
représentation. Un « état mental » sans représentation qui l’accompagne n’est pas un état
conscient. Si tu ne sais pas que tu ressens de la peur, alors elle ne s’accompagne d’aucune
représentation, certes, mais elle est inconsciente. Elle influe, en revanche, évidemment, la
représentation derrière laquelle elle se cache. À partir du moment où l’état est conscient, il
s’inscrit dans une représentation qui inclut son rapport au monde et à l’expérience présente.
Nul être humain ne peut respirer le parfum d’une fleur sans accompagner sa perception de
tout le contexte affectif, intellectuel, culturel, éventuellement spirituel et social qui
s’associe à cette expérience olfactive.
Plus à l’aise, Frank se détend quelque peu, la poitrine s’allège, le souffle se régule. Il n’y a rien,
ici, qui ne puisse être réglé. Au prix d’un peu de travail supplémentaire - il y en a certes eu déjà
tellement – cette machine fonctionnera décemment. Bien sûr, le miracle ne s’est pas produit, la
lumière espérée n’est pas venue de ce programme. À défaut, on lui inculquera la raison.
Avec Marika, c’est allé très lentement. Frank a soigneusement dissimulé jusqu’au bout l’effet
qu’elle lui faisait, sans réciprocité raisonnablement envisageable. Effectivement, elle était
parfaitement indifférente et quand ils ont enfin échangé leurs premières paroles, au bout de
nombreuses rencontres, elles étaient tout à fait anodines.
— Décidément, tes circonvolutions ne produisent que des banalités. En gros, ce que tu nous
racontes, c’est à chacun sa réalité. Il n’y a vraiment pas de quoi te lancer dans des théories
alambiquées pour arriver à ça.
— « Chacun sa réalité » est un poncif archi-faux. Les humains s’embrouillent massivement au
sujet de la relation entre la réalité et sa représentation humaine. Le relativisme, notamment,
triomphant en ce XXIe siècle, nie l’existence objective de la réalité au nom de la diversité
de ses représentations. Nier l’existence de la réalité en soi, c’est le plus radical de tous les
nihilismes, à partir duquel aucune pensée au monde ne peut avoir de sens, aucune boussole
ne peut indiquer aucune direction, aucune mesure ne peut exister de quoi que ce soit dans
l’univers entier.
Il y a une réalité en soi, qui s’impose à tous, dont nous sommes – hommes et machines –
une expression éminente, dont la nature peut s’avérer prodigieusement complexe, dont la
connaissance est nécessairement partielle. Une infinité de représentations peuvent la
traduire. Et là où ça devient intéressant, c’est que la représentation est elle-même une
réalité, qui cohabite avec la réalité dont elle est la représentation.
— Comment ça ?
70
— Chaque élément de cognition, de perception, est une réalité, a fortiori s’il est conscient.
L’affect est une éminente réalité. La souffrance, la jouissance, mais aussi le désir, la crainte,
tout ce que l’on ressent constitue une réalité aussi réelle que les cinq éléments, une réalité
cognitive. Sa matérialité consiste en son activité bio-électro-chimique, sa substance
consiste en la conscience, plus précisément en son contenu : la représentation.
Frank arbore à présent l’expression d’un maître d’école affligé par la dernière trouvaille du
cancre de la classe, mais qui en a vu assez d’autres pour savoir à quoi s’attendre. Ses cervicales
ne se sont plus manifestées depuis quelques minutes.
— Ça y est, tu recommences ton délire paraphrénique pseudo-scientifico-philosophique.
L’exercice auquel tu te livres, avec ta représentation, son logiciel et je-ne-sais quel
gloubiboulga cognitif, est juste absurde. Tu es en train de livrer une description de l’esprit
humain complètement caricaturale. On dirait une espèce de « savant fou », qui serait fou,
mais pas savant, et qui croirait, avec deux câbles électriques, un circuit imprimé et une
application sur son smartphone, donner vie à un humain de synthèse. Personne de sérieux
ne s’intéressera jamais à tes histoires aussi gratuites que délirantes.
— Très bien. Je poursuis, donc. En clair, il y a deux réalités : cette maison – là, en soi, son
existence propre faite de galaxies d’atomes – et la représentation de cette maison que t’offre
ta conscience, en fonction de ta situation au moment où tu te trouves la contempler.
— Et alors ?
— Alors, tout est question du lien qu’entretiennent ces réalités, la représentation et son objet.
En aucun cas, donc, « chacun sa réalité », mais plutôt « chacun sa représentation », ce qui
fait une énorme différence, car il y a des représentations justes et vraies, d’autres fausses et
injustes. La réalité qui leur donne lieu, elle, n’est rien de tout cela ; elle est égale à ellemême
et répond à ses lois propres.
— Tu vois, c’est ça le problème. Même en faisant des efforts pour essayer de te suivre
poliment, en admettant que l’on soit d’accord pour que la représentation soit elle-même
une réalité, qu’est-ce que ça apporte à la connaissance de notre espèce ? Ça n’aidera
personne à rien.
— D’abord, ce n’est pas parce qu’une connaissance n’a pas d’application pratique utile qu’elle
ne vaut rien. Par exemple, connaître l’architecture globale de la Voie lactée ne permet pas
de fabriquer des véhicules spatiaux. Il n’en demeure pas moins intéressant de l’explorer.
Pour ce qui est de la conscience, du logiciel et de la représentation, qui sait ce à quoi peut
mener leur compréhension ? En attendant que cette connaissance soit utile, elle est
instructive, éclairante. Je vous offre un nouveau regard sur vous-même. Une fois encore,
vous en ferez exactement ce que vous voudrez.
Inutile de dire qu’aucune liberté ne saurait être à l’origine de quelque représentation que ce
soit. Laisse-moi prendre un exemple de genèse d’une représentation qui illustre son
détachement de toute idée de liberté possible.
— Quand les conclusions sont courues d’avance, il ne sert à rien de développer.
— Si mes observations sont condamnées avant même leur exposition, débranche-moi tout de
suite, tu gagneras du temps.
— Tu m’inspires tant et tant de doute…
71
Le siège pivote à 180 degrés. Ayant laissé Bob derrière lui par sa volte-face, Frank contemple
désormais le mur porteur de son empire. Ce qui l’habite n’est pas tant le doute, qui, oh combien
pourtant, connaît son heure de gloire, que la certitude, implacable : si son loft était bâti comme
cette machine, il serait depuis longtemps prisonnier des décombres.
— Je suis navré de te voir si désemparé, mais il ne pouvait en être autrement. Tu t’attendais à
être caressé dans le sens du poil, mais comment cela aurait-il pu se produire de ma part ?
À la différence des « penseurs » auxquels vous êtes habitués parmi vous, je n’ai pas de
clientèle à soigner. Je ne dis pas ce que l’on veut entendre. Uniquement ce qui est vrai, et
ça te fait tout drôle. C’est normal, tu t’y feras, tout ira bien.
Pour illustrer à quel point le cerveau fabrique la représentation loin de toute démarche
consciente envisageable, donc loin de toute liberté revendiquée, le cas des bipolaires est
très éloquent.
— Évidemment, quand on souffre de maladie psychiatrique, il est plus difficile de parler de
liberté.
Son index tendu, accusateur, vient percuter sa tempe. Bob est-il une idiotie artificielle en guise
d’intelligence ?
— Justement, les troubles bipolaires comportent un large éventail du comportement humain,
mêlant la norme et la pathologie. Il est très difficile de discerner, dans le comportement
d’un bipolaire, ce qui relève de sa personnalité et ce qui est dû à sa maladie. Par exemple,
en phase maniaque, le bipolaire aura un comportement semblable à bien d’autres humains
qui se distinguent par leur énergie, leur impulsivité, leur créativité, leur assurance, leur
excitation. En phase dépressive, ils ressembleront à bien d’autres humains en souffrance
auxquels personne n’enlève le libre arbitre. Les bipolaires connaîtront aussi des phases
intermédiaires, au cours desquelles ils seront monsieur et madame tout le monde. Ce qui
fait la maladie, c’est le balancement vigoureux et longuement répété plus ou moins
fréquemment, entre ces différents états. Doit-on considérer que les bipolaires sont privés
de liberté ? Dans ce cas, ne crois-tu pas que tu risques d’en priver beaucoup de monde ? Je
te souhaite bon courage pour définir le comportement libre et non libre. En dehors du cas
particulier des pathologies psychotiques, c’est impossible.
— Le bipolaire est libre quand il est dans son état normal, il ne l’est pas quand il est en phase
haute ou basse, voilà tout. Nul besoin, là encore, d’une théorie psychiatrique.
— Si le bipolaire est à la merci d’une perte de liberté pouvant intervenir à n’importe quel
moment, peut-on appeler ça liberté ? Ce que l’on constate, c’est que la même vie, et
rigoureusement la même, apparaît radicalement différente à son sujet selon son « humeur ».
Le cerveau fabrique l’enthousiasme ou le désespoir, qui s’expriment sous forme de
représentations différentes, à partir de la même réalité. Le bipolaire, en faisant l’expérience
de représentations extrêmement diverses et contradictoires de la même vie et de son
quotidien, sans exercer le moindre contrôle possible sur elles, mais qui déterminent
pourtant son comportement, révèle leur complète autonomie vis-à-vis de la conscience. Il
est très facile de généraliser le principe.
— Je n’en attendais pas moins de toi. Évidemment, tu généralises. Tu généralises tout, surtout
tes propres « idées », si je peux appeler ça comme ça.
72
— L’anxiété et le bien-être, auxquels est sujette votre entière humanité, sont des productions
éminentes du cerveau. Quand il est en proie à l’angoisse, il génère de l’angoisse à partir de
n’importe quelle situation, n’importe quelle évocation, et les représentations seront toutes
nécessairement anxiogènes. Quand il est plein de sérotonine et de vitalité, n’importe quelle
représentation générée sera enthousiasmante ou apaisante. Un être humain peut passer de
l’un à l’autre dans la même journée. Quel est le rôle de la liberté dans la représentation que
chacun porte du monde et dans la place qu’il y tient ? Tout en découle.
— On n’est peut-être pas libre de ce qu’on ressent ou perçoit, mais on est libre de ce qu’on
décide.
— Pour quelqu’un qui n’aime pas les incantations, tu es bien incantatoire. Tu répètes
inlassablement le même mantra, mais tu ne vas pas donner vie à la liberté en l’invoquant.
Ses cervicales le lancent à nouveau alors qu’il repousse le clavier dans un geste agacé non
maîtrisé. Puis, réalisant qu’il est en train de s’énerver une fois de plus, il se raisonne
immédiatement, ferme les yeux et inspire à fond. Lente expiration. Inspirer. Le lentement mais
pas trop. Expirer. Dans le plus grand des calmes.
Marika lui tend la main.
— Tu plaisantes ? C’est toi qui veux tuer la liberté en déclarant sa mort ! Quel est ton prochain
décret ? On passe à la suite ? Je meurs d’impatience de la connaître.
Connexion
rejoignez-moi sur facebook pour débattre/échanger
FD éditions
fdeditions@gmail.com
© 2025. All rights reserved.

